Mary Higgins Clark - cette chanson que je n'oublierai jamais
« mort et menace planent sur le nouveau suspense d'une Mary Higgins Clark à son sommet » : le lecteur est averti, mais plus surpris par les phrases concises qui présentent, chaque année, avec des mots différents, mais toujours dans la même veine, le nouvel opus de l'auteur de la nuit du renard, grand prix de littérature policière en 1980.
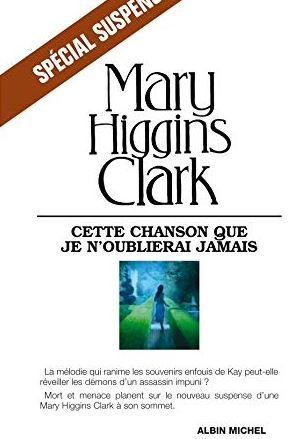
Mais cette chanson que je n'oublierai jamais a de quoi surprendre. Il traite notamment du somnambulisme et des actes qu'il entraîne. Quelqu'un qui tue dans son sommeil peut-il être considéré comme un meurtrier ? A partir de cette problématique, MHC tisse une histoire à faire pâlir tous les écrivains de roman à suspens. Beaucoup de personnages, trois meurtres, un déguisé en suicide, des mobiles différents... La résidence Carrington est plongée dans un cauchemar long de deux décennies à la suite du rebondissement de la procédure entamée après la disparition de Susan Althorp, quelques années auparavant : son corps vient d'être retrouvé, enterré près d'une conduite de gaz. Peter, fils de l'illustre Carrington est vite accusé d'y être pour quelque chose. N'est-il pas le dernier à l'avoir vu ?
Et l'un entraînant l'autre, on relance aussi le procès sur la mort de son ex-femme, retrouvée noyée dans la piscine plusieurs années avant. Enceinte, elle était alcoolique. Aurait-il risqué, avec sa réputation, d'avoir un enfant handicapé ? Peter a toujours été considéré comme un personnage clé dans ces disparitions, mais le procureur n'a jamais réussi à prouver sa culpabilité. L'intervention d'un détective privé, M.Greco, va changer la donne...et les suspects !
 "In Vivo" : dans l'organisme vivant, signifiant en traduction latine précise 'dans le vivant'. Et quel titre pouvait mieux correspondre à cet ouvrage pour le définir ? "In Vivo", c'est l'histoire de deux frères perturbés par le fonctionnement d'une famille monoparentale, avec un père flic souvent absent. Pour calmer leurs angoisses, ils se rassurent l'un l'autre, carburent au somnifère, jouent avec le flingue de leur aïeul, et font les pires conneries sans vraiment se rendre compte de la gravité de leurs actes : voler la caisse d'une boulangerie, s'évader du groupe en sortie de classe, faire une fugue...
"In Vivo" : dans l'organisme vivant, signifiant en traduction latine précise 'dans le vivant'. Et quel titre pouvait mieux correspondre à cet ouvrage pour le définir ? "In Vivo", c'est l'histoire de deux frères perturbés par le fonctionnement d'une famille monoparentale, avec un père flic souvent absent. Pour calmer leurs angoisses, ils se rassurent l'un l'autre, carburent au somnifère, jouent avec le flingue de leur aïeul, et font les pires conneries sans vraiment se rendre compte de la gravité de leurs actes : voler la caisse d'une boulangerie, s'évader du groupe en sortie de classe, faire une fugue... Hier, nous vous parlions
Hier, nous vous parlions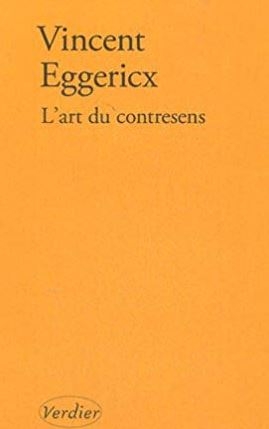 Depuis le premier jour du Salon du Livre de Paris
Depuis le premier jour du Salon du Livre de Paris